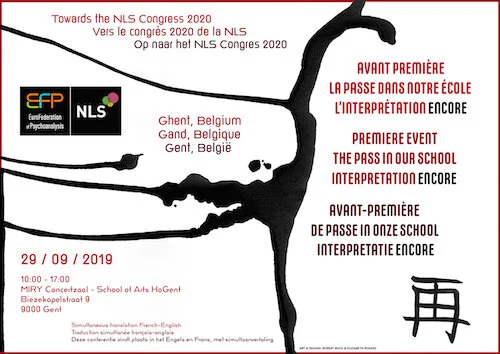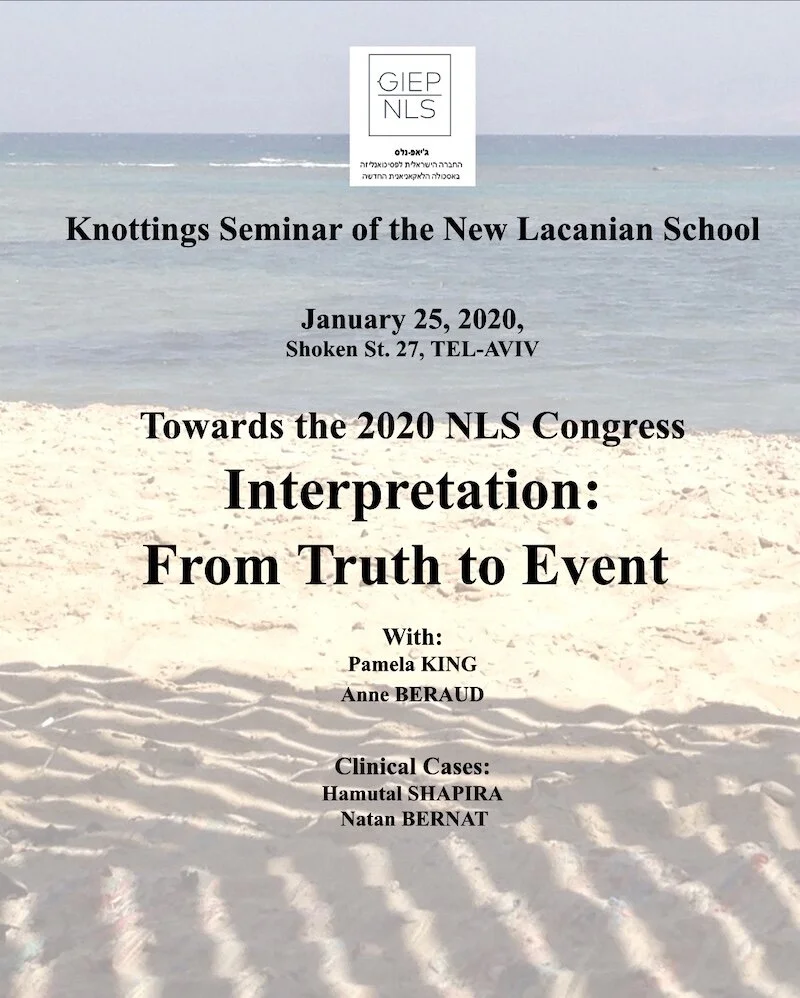D'autres textes d'orientation
Quels mots, quel corps ?
Anne Lysy*
Texte de l’intervention prononcée lors du colloque organisé par la New Lacanian School en collaboration avec l’Eurofédération de Psychanalyse « Avant Première. La passe dans notre École – L’interprétation Encore » qui a eu lieu à Gand le 29 septembre 2019.
« Il y a des mots qui portent, et d’autres pas. C’est ce qu’on appelle l’interprétation » [1], dit Lacan à Nice fin 1974. Mais comment ont-ils un impact, comment touchent-ils à la jouissance ? C’est là toute la question !
« Analyser le parlêtre, ce n’est plus exactement la même chose que d’analyser l’inconscient au sens de Freud, ni même l’inconscient structuré comme un langage » [2]. Jacques-Alain Miller nous donne des balises précieuses pour nous repérer dans les renversements conceptuels du dernier enseignement de Lacan, sur lesquelles j’appuie mon propos. Il y a une grande solidarité entre la doctrine que l’on a de l’inconscient et l’idée qu’on se fait de l’interprétation. Dans son Séminaire xxiv, Lacan disait vouloir aller « plus loin que l’inconscient » avec « l’une-bévue » [3] . Eh bien, il nous faut aller plus loin concernant l’interprétation. Le mot même d’interprétation, dit J.-A. Miller, ne convient plus tout à fait pour nommer l’opération analytique quand ce qu’elle vise est le sinthome, c’est-à-dire l’au-delà de la dialectique du désir et du scénario du fantasme. Qu’est-ce que l’interprétation quand ce qui est visé n’est plus la révélation de la vérité inconsciente ou le sens des symptômes par le déchiffrage signifiant, articulation de S1 et S2 ? Si nous analysons le parlêtre, le corps parlant, et visons le réel du sinthome, qui est événement de corps, qui justement résiste à tout déchiffrage, quelle pratique interprétative inventer qui soit à la hauteur de ce réel-là ?
Interprétation-événement, vocifération, jaculation, sidération, y mettre son corps, passer dans les tripes sont autant de termes relatifs à cette « pratique post-interprétative » [4], qui dessinent une zone où le corps est impliqué. Quel corps, quels mots ?
Au début de cette année de travail qui nous mène au congrès, j’ai plus de questions que de réponses ! Je vais essayer d’en formuler quelques-unes aujourd’hui, pour y voir un peu plus clair.
Ma première impression est la suivante. La question de l’interprétation et celle du corps est complexe, elle ne se réduit sans doute pas à la présence du corps de l’analyste, au sens où on en parle parfois : il intervient avec son corps, il gesticule, il hurle. C’est un des aspects, mais il demande à être situé. Au fond, je crains a priori que cette idée du corps de l’analyste soit un peu imaginaire, comme on dit. Oui, mais… – après tout, ce n’est pas forcément une objection.L’imaginaire n’est-il pas réhabilité à la fin de l’enseignement de Lacan ? Il est situé dans le nœud rsi. Cette piste est donc à explorer : comment prendre la question avec les nœuds ? Autrement dit : comment décrire une interprétation et ses effets en la situant dans les trois dimensions ? Ou encore, qu’est-ce que serait une interprétation borroméenne, ou ce que Lacan appelle une fois dans son Séminaire Le Sinthome une « manipulation dite interprétative » [5] – à l’instar de la manipulation, avec ses mains, des nœuds qu’il construisait ?
J’essaie d’avancer dans ma réflexion en prenant des exemples. Je commence par « l’interprétation sans parole » [6] dont a fait état Monique Kusnierek dans sa passe, et qui est devenue un paradigme. Après la fin de la séance, dans le couloir obscur qui conduit à la porte, elle est amenée à se retourner parce qu’elle entend un bruit, une sorte de grognement : « elle voit son analyste qui fait le geste d’une bête féroce prête à se jeter sur sa proie » [7]. C’est une « pantomime de dévoration » [8], commente J.-A. Miller, dans son cours « L’expérience du réel » en janvier 1999. Il prend là cet exemple pour distinguer l’interprétation comme déchiffrage, qui concerne le refoulé et le retour du refoulé, et l’interprétation-dérangement de la défense. Le déchiffrage laisse en défaut « que dans l’analyse il faut que l’un et l’autre apportent leur corps » ; l’interprétation-dérangement, elle, concerne le « parlêtre où la fonction de l’inconscient se complète du corps » – disons approximativement : « pas du corps symbolique, pas du corps imaginaire, mais de ce qu’il [y] a de réel du corps » – et elle « mobilise quelque chose du corps. C’est un mode de l’interprétation qui exige qu’elle soit investie par l’analyste et par exemple qu’il y apporte – ce qui n’arrive pas quand on se met à traduire le texte tout simplement – le ton, la voix, l’accent, voire le geste et le regard. » [9]
Monique Kusnierek, dans son texte, analyse le contexte et les effets de cette interprétation où fait irruption un objet inattendu : le lieu, le geste combiné au son, constituent une scène qui s’inspire d’un cauchemar répété où pointe la pulsion orale, un se faire dévorer ; en même temps que la pulsion monte sur scène, l’analyste joue la bête féroce, c’est-à-dire « réduit l’Autre du fantasme à son semblant » [10]. Ce qui déclenche le rire. Cela fait déconsister cet Autre, avec les conséquences qu’elle en tire pour terminer son analyse.
Bernard Porcheret raconte qu’à la sortie d’une séance, étonné par l’absence de bruits de portes ou de pas, il se retourne et voit dans la pénombre l’analyste figé, faisant face au mur, mimant le croque-mort. Interprétation décisive, l’analyste muet et sans regard le sépare de ce signifiant-maître qui l’écrasait [11].
Vous avez sûrement entendu dans Rendez-vous chez Lacan[12] Suzanne Hommel témoigner de ce geste inoubliable de Lacan : elle lui dit qu’elle se réveille chaque jour à cinq heures, que c’est l’heure où la Gestapo venait chercher les Juifs. Lacan se lève comme une flèche de son fauteuil, vient vers elle et lui fait une caresse extrêmement douce sur la joue. « J’ai compris geste-à-peau », dit-elle ; un geste surprenant, extrêmement tendre, qui n’a pas diminué la douleur mais en a fait autre chose. « Je l’ai encore sur la joue », dit-elle, quarante ans après ; « c’est aussi un appel à l’humanité, quelque chose comme ça ».
D’autres exemples me viennent, cette fois plus sonores. Une interprétation dont Véronique Voruz a témoigné ici à Gand, peu après sa nomination d’ae[13], qu’elle a appelée « exorcisme par équivoque »[14] ; celle qui après de nombreuses années a touché un symptôme récurrent rougissant ses yeux tel un monstre ou un diable. Là aussi, comme dans chaque exemple, le contexte et les mots en jeu sont singuliers. Je résume. Sortie après de longues années d’une position d’invisibilité, stratégie pour se protéger du regard maternel haineux, ses prises de parole personnelles en public se payaient de ces infections oculaires carabinées, retombées du regard maternel sur elle ; jusque-là des interprétations dans le registre des effets de sens, de vérité, n’avaient rien pu y faire. Elle se précipite chez l’analyste : « C’est mon histoire d’yeux… » L’analyste bondit, rugit : « Dieu ! Enfin je l’entends ! » et coupe la séance [15]. Cette fois le symptôme cède, et avec lui la croyance en son « bon vieux Dieu » [16] à elle, celle d’être le monstre ou le diable dans la lignée des femmes. Cette interprétation touche à la fixation de jouissance, dit-elle. Qu’est-ce qui a opéré ? Outre l’homophonie, il y a le ton, le rugissement, la vocifération, et aussi la coupure de la séance.
Nous en avons souvent le témoignage : dans certaines interprétations marquantes le ton fait que les mots portent. J’en ai moi-même fait l’expérience, et j’en ai parlé comme AE, avec le « En somme, vous êtes une coureuse ! » [17] lancé à la figure, qui ponctuait la séance, ou une autre fois le murmure presque inaudible du commentaire dans le couloir : « Je déborde d’énergie ! C’est votre style, c’est votre façon de faire… » [18] Pas sûr que les mêmes mots, sans le ton, qui tranchait sur les autres paroles, auraient frappé, avec cet effet de sidération, pour les premiers, et un « réaménagement », ai-je dit pour les seconds, un effet de « rectification de jouissance », pour reprendre les termes de J.-A. Miller ; ce dont je me plaignais, c’est ça qui me satisfait [19].
Un dernier exemple, d’interprétation par l’équivoque, digne d’une anthologie, rapportée par Aurélie Pfauwadel, de sa phobie infantile des cafards et des souris : « vous répondez au cafard de votre mère, en lui disant : souris » [20]. Cela se passe plutôt au début de l’analyse et ces mots produisirent un tel effet de vérité, qu’elle, qui collait au sens, devint ce jour-là lacanienne ! Ce Witz, ce mot d’esprit, – dont Aurélie ne dit rien du ton –, dévoila à la fois sa position subjective et le ravage maternel, et lui permit de se séparer du cafard de sa mère.
Ces exemples un peu disparates m’amènent à quelques remarques et questions.
1) L’analyste fait-il la même chose aux différents moments de la cure – l’analyse qui commence, qui dure, qui finit ?[21]Est-ce que l’orientation vers le sinthome implique que le déchiffrage soit dépassé ? Pas tout à fait, dans la mesure où « pour traiter le symptôme, il faut bien en passer par la dialectique mouvante du désir » [22], par les avenues du sens ; entre l’écoute de la dialectique de l’être et l’écoute de l’itération du symptôme, « l’analyste circule parce qu’il y a là deux dimensions qui ne sont raccordées que par un hiatus » [23].
2) Le mot d’esprit, qui est équivoque, « donne le modèle de la juste interprétation analytique » [24], dit Lacan. Ou encore : « c’est la seule arme qu’on ait contre le sinthome » [25]. Ce n’est pas en remettre sur le sens, c’est plutôt « un dire qui n’ait pas de sens » [26] comme moyen de toucher à l’irréductible des marques de jouissance. Sur la nature de l’équivoque, et ses bougés, du premier au dernier Lacan, où elle produit un effet de sens et un effet de trou, tout un champ de recherche nous attend ! Les deux premiers exemples cités ci-dessus relèvent-ils de l’équivoque ?
3) Je voudrais aussi examiner et mieux distinguer les différents registres du sonore. Aux États-Unis, Lacan disait : « L’interprétation doit toujours – chez l’analyste – tenir compte de ce que, dans ce qui est dit, il y a le sonore, et que ce sonore doit consonner avec ce qu’il en est de l’inconscient. » [27] Ce « sonore » peut s’entendre comme l’homophonie translinguistique du « Glanz auf der Nase » (du patient fétichiste de Freud)[28]. Ce peut être le son « Grrr… » de mon premier exemple. Ce peut être aussi la résonance telle que Lacan l’aborde dans son Séminaire Le sinthome : il y a « quelque chose dans le signifiant qui résonne » [29], et la parole a des effets dans le corps : « les pulsions, c’est l’écho dans le corps du fait qu’il y a un dire » [30]. Ce peuvent être encore le cri, la vocifération, la jaculation, le ton – dont Lacan parle dans le Séminaire xxiv. Tout ça se fait écho, mais est-ce du même ordre ? Quel est le statut de la voix ou de la phonation dans ces derniers séminaires – par rapport à la voix « aphone », objet indicible, dans la perspective structurale du sujet dans la chaîne signifiante, que décrivait J.-A. Miller en 1988 dans son article « Jacques Lacan et la voix » [31] ?
Dans son cours « Choses de finesse » en 2009, J.-A. Miller met en valeur que l’interprétation est « un mode de dire spécial […] qui accentue, dans le signifiant, la matérialité, le son ; […] un usage du signifiant qui n’est pas à des fins de signification, […] mais où c’est […] la consistance même du son, qui pourrait faire résonner la cloche de la jouissance […], pour que l’on puisse s’en satisfaire » [32]. « C’est pourquoi Lacan a pu dire que l’interprétation efficace était peut-être de l’ordre de la jaculation » [33].
4) Maintenant l’événement : le symptôme événement de corps et l’interprétation-événement ; ces termes s’impliquent mutuellement. Viser le sinthome qui est événement de corps, trace de la rencontre traumatique de la langue et du corps, n’est possible que par un mode d’interprétation qui engendre des effets de jouissance, voire qui s’égale à un événement de corps. C’est dans cette perspective que J.-A. Miller accorde autant d’importance au corps : « Il faut y mettre le corps pour porter l’interprétation à la puissance du symptôme. » [34] Lacan a pu dire que l’analyste est un sinthome [35] ; J.-A. Miller propose qu’il « jouera à l’événement de corps, au semblant de traumatisme » [36]. Y mettre le corps, me disait Véronique Voruz il y a quelques jours, c’est produire le même effet sur le corps que le dire dont la pulsion est l’écho pour parvenir à opérer sur ladite pulsion.
5) Jusqu’ici j’ai parlé de l’interprétation comme venant de l’analyste. Une dernière question, alors. Pour que les mots portent, est-ce essentiel qu’ils soient dits par l’autre, par l’analyste ? La parole analysante produit-elle parfois un dire, qui a des effets ? N’aurait-il son effet que par la coupure ? Et puisque nous travaillons à l’amp sur le rêve, un rêve peut-il faire événement ? Je pense notamment à certains rêves de fin d’analyse.
Voilà donc quelques questions qui, je l’espère, n’obscurcissent pas plus qu’il ne faut le champ à explorer. Il ne s’agit bien évidemment pas d’idéaliser ou d’imiter un style d’analys(t)e ni d’établir une nouvelle technique psychanalytique (sautez, grimacez, criez…), mais de s’affronter à notre tour à ce que Lacan a osé : « la mise en question la plus méditée, la plus lucide, la plus intrépide, de l’art sans pareil que Freud inventa, et que l’on connaît sous le pseudonyme de psychanalyse » [37].
* Anne Lysy est psychanalyste à Bruxelles, Belgique, membre de l’ECF, de la NLS et de l’AMP.
1- Lacan J., « Le phénomène lacanien », Conférence à Nice le 30 novembre 1974, Les cahiers cliniques de Nice, n° 1, juin 1998, p. 14.
2- Miller J.-A., « L’inconscient et le corps parlant », La Cause du désir, no 88, octobre 2014, p. 109-110.
3- Lacan J., Le Séminaire, livre XXIV, « L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre », leçon du 16 novembre 1976, inédit.
4- Miller J.-A., « L’interprétation à l’envers », La Cause freudienne, no 32, février 96, p. 13.
5- Lacan J., Le Séminaire, livre XXIII, Le sinthome, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 2005, p. 39.
6- Kusnierek M., « Une interprétation sans parole », in Miller J.-A. et 84 amis, Qui sont vos psychanalystes ?, Seuil, Paris, 2002, p. 23-26.
7- Ibid., p. 24.
8- Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. L’expérience du réel », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris 8, cours du 27 janvier 1999, inédit.
9- Ibid.
10- Kusnierek M., op. cit., p. 26.
11- Porcheret B., « La pulsion est vorace », La Cause du désir, n° 83, janvier 2013, p. 63.
12- Rendez-vous chez Lacan, film écrit et réalisé par Gérard Miller, dvd, Éditions Montparnasse, coll. Regards, 2012.
13- Voruz V., « Une histoire d’yeux », Conférence à Gand le 5 décembre 2015, suivie d’une conversation avec A. Lysy, Quarto, n° 112-113, mai 2016, p. 90-91.
14- Voruz, V., « Le bon vieux Dieu », Quarto, n° 114, octobre 2016, p. 77.
15- Cf. Voruz V., « Une histoire d’yeux », op. cit., p. 90-91 ; Ibid.
16- Ibid.
17- Lysy A., « Des mots qui portent, » La Cause freudienne, n° 78, février 2011, p. 141.
18- Cf. ibid., p. 142.
19- Cf. Lysy A., « Il n’y a pas… et il y a », Quarto, n° 100, septembre 2011, p. 24 ; « Des mots qui portent » op. cit., p. 142-143 ; « Ma petite chansonnette. Variations sur l’événement de corps », Quarto n° 103, décembre 2012, p. 55-56.
20- Pfauwadel A., « La passion de l’a-pproche », La Cause du désir, n° 98, mars 2018, p. 161.
21- Cf. Miller J.-A., « Une psychanalyse a structure de fiction », La Cause du désir, n° 87, juin 2014, p. 69.
22- Miller J.-A., « Lire un symptôme », Mental, n° 26, juin 2011, p. 58.
23- Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. L’Un tout seul » (2010-2011), enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris 8, cours du 4 mai 2011, inédit.
24- Lacan J., « Le phénomène lacanien », op. cit., p. 24.
25- Cf. Lacan J., Le Séminaire, livre XXIII,, Le sinthome, op. cit., p. 17.
26- Lacan J., « Le phénomène lacanien », op. cit., p. 16.
27- Lacan J., « Conférences et entretiens dans des universités nord-américaines », Scilicet 6/7, novembre 1976, p. 50.
28- Lacan y fait référence aussi bien à Nice qu’aux États-Unis, pour dire que « c’est au niveau de lalangue que porte l’interprétation ».
29- Lacan J., Le Séminaire, livre XXIII, Le sinthome, op. cit., p. 17.
30- Ibid.
31- Miller J.-A., « Jacques Lacan et la voix », Quarto, n° 54, juin 1994, p. 47-52.
32- Miller J.-A., « L’économie de la jouissance », La Cause freudienne, n° 77, mars 2011, p. 146.
33- Ibid.
34- Miller J.-A., « Une fantaisie », Mental, n° 15, février 2005, p. 26.
35- Cf. Lacan J., Le Séminaire, livre XXIII, Le sinthome, op. cit., p. 135.
36- Miller J.-A., « L’inconscient et le sinthome », La Cause freudienne, n° 71, juin 2009, p. 79.
37- Miller J.-A., 4e de couverture du Séminaire de J. Lacan, livre XXIII, Le sinthome, op. cit.
Quelle place pour le corps ?
Pamela King
Texte théorique présenté lors du séminaire Nouages à la Société GIEP-NLS à Tel-Aviv le 25 janvier 2020, qui trace la formalisation du corps dans l’enseignement de Lacan.
Pendant ce séminaire Nouages ici à Tel-Aviv, je vais parler d’un nouage spécifique, impliqué dans le titre du prochain congrès de la NLS : L’interprétation, de la vérité à l’événement. Il s’agit du nouage entre langue et corps. C’est ce point que Bernard Seynhaeve souhaite développer, comme il dit dans son argument qui prépare le congrès : « l’interprétation analytique est en elle-même un nouage de lalangue et du corps de l’analyste[1] ». En effet, à travers son séminaire, Lacan essaie de trouver l’articulation entre ces deux « dimensions hétérogènes[2] » : d’une part, l’inconscient comme langage, et d’autre part, le versant pulsionnel ou de jouissance.
C’est par le biais du corps que je vais brièvement examiner cette articulation. Le registre du corps évolue dans l’enseignement de Lacan : le corps imaginaire est livré au miroir comme unité ; le corps symbolique est pris dans les signifiants qui le nomment et le désigne comme identité (tu es un garçon, une fille, etc.) ou bien le corps symbolisé est blason, armoiries ; et le corps réel est ce corps vivant affecté de jouissance[3]. Parallèlement à cette évolution, l’idée que l’on se fait de l’interprétation change jusqu’à devenir « une pratique post-interprétative[4] » où « l’âge de l’interprétation est clos[5] ». Je vais terminer en revenant à l’intervention de Anne Lysy (ci-dessus) lors du colloque du 29 septembre dernier à Gand pour illustrer des façons variées comment dans notre pratique analytique aujourd’hui une interprétation ne vise plus la révélation d’une vérité inconsciente, mais vise le réel du corps.
La formalisation du corps à travers l’enseignement de Lacan
À travers son enseignement, Lacan a formulé sa doctrine du corps de différentes façons. Ces diversités conceptuelles du corps procèdent de façon logique à mesure du progrès de son élaboration. Après le retour à Freud, le développement de son enseignement a conduit Lacan à chercher l’issue aux impasses confrontées par le père de la psychanalyse. « La psychanalyse change », a dit Jacques-Alain Miller qui nous oriente dans la pensée de Lacan et nous invite à « apercevoir à certains éclairs, trouant les nuées obscurs du propos de Lacan, qu’il réussit à faire saillir un relief qui nous instruit sur ce que devient la psychanalyse[6] ». Pour suivre la formalisation du corps à travers l’enseignement de Lacan, je m’appuierai sur « Les six paradigmes de la jouissance » de Miller ainsi sur un texte récent de Damien Guyonnet, « Le sujet de l’inconscient et le corps », qui propose l’hypothèse que durant tout un temps de l’enseignement de Lacan, c’est à travers l’objet a que ce registre du corps est convoqué.
Le corps imaginaire : un affairement jubilatoire
Dans son tout premier enseignement, Lacan a formalisé sa conception du corps à partir du l’image de l’autre. Le corps du stade du miroir a été la première manière dont Lacan a abordé la question du corps. L’infans s’identifie à l’image de son corps dans le miroir, et c’est en s’identifiant à ce leurre, avec la médiation d’un Autre qui reconnait et nomme l’image, qu’il peut acquérir une forme « orthopédique de sa totalité[7] ». C’est un « moment de nouage[8] » entre l’imaginaire de cette image corporelle et le symbole du moi, un moment inaugural où le sujet reconnait l’image de son propre corps et qu’« il éprouve ludiquement[9] ». Lacan n’utilise pas encore le terme « jouissance », terme que nous référons au corps, mais il appelle cette rencontre avec le corps un « affairement jubilatoire[10] » : il y a donc une jouissance liée à l’assomption d’une image, qui est d’ordre imaginaire. Ce qui compte dans cette image c’est l’investissement libidinale.
Deux axes : parole et corps
À cet époque-là, cette dimension de la jouissance est exclue du registre symbolique, ou du moins de sa formulation. Dans le schéma L[11], Lacan disjoint et oppose les deux axes, imaginaire (libidinal) et symbolique. Il y a les lois formelles du symbolique d’un côté, et la jouissance du corps libidinale de l’autre. Pour faire une cure, il serait question de parole et de langage. « L’analyse ne peut avoir de but que l’avènement d’une parole vraie[12] », dit Lacan en 1953, faisant ainsi une affirmation du pouvoir de la parole et montrant une foi en l’avènement de la vérité du sujet. L’analyste mène la cure à partir de la place de l’Autre comme pivot des articulations symboliques de l’inconscient. L’interprétation qui se centre « seulement sur la parole ou l’énoncé[13] », serait une opération signifiante sur une matière signifiante, ou « une délivrance du sens emprisonné[14] ». La parole vraie – avec un processus de reconnaissance incluant un Autre sujet – peuvent produire un signifiant de l’être du sujet. Ici il n’est nullement question de corps puisque le corps ne relève pas du pur logique.
Le corps couvrant le sujet barré
Mais Miller nous rappelle le « manque essentiel » derrière cette image du corps : « La constance avec laquelle Lacan rend compte de la prééminence du corps propre chez les êtres humains a à voir avec la supposition d’un manque, la supposition d’une faille, que l’image du corps viendrait colmater, recouvrir. On ne peut pas comprendre le privilège spécifique de cette image, l’importance qu’elle a chez les êtres humains, sans supposer qu’elle vient cacher un manque essentiel[15]. »
Alors l’enseignement de Lacan évoluera – nous verrons la naissance du sujet barré et aussi les premiers apports concernant objet a. Dans « La direction de la cure » (1958), si le sujet n’est « sujet en tant qu’il parle[16] », c’est un sujet barré, un sujet en manque d’être, pour lequel il y a « incompatibilité du désir avec la parole[17] ». Face à cette absence fondamentale il ne sera plus question d’interpréter pour produire « du sens qui se comprend, sans aucune limite[18] ». L’effet de vérité de l’interprétation, souligne Éric Laurent dans son texte d’orientation du congrès, va renvoyer maintenant « à un vide fondamental, une absence première de l’objet perdu[19] ». Je le cite : « L’hétérogène de l’interprétation […] c’est un n’importe quoi qui doit viser le vide de l’absence première de l’objet perdu. Il s’accompagne d’une marque particulière, d’une marque prélevée sur la vie, et marque le lieu d’un non-objet que [Lacan] dénommera bientôt objet a[20]. »
L’objet a – le lien au corps vivant
À cette époque de son enseignement, si c’est du côté de l’imaginaire qu’il situe le corps et le registre libidinal, Lacan va dégager progressivement un objet particulier, l’objet a, à situer au point de croisement des deux axes. Ce point est « là où le registre libidinal se trouve finalement à se loger au sein du symbolique[21] ». De ce vide premier, Lacan en déduira un nouvel algorithme, celui du « fantasme fondamental[22] » (1959) : $<>a . Il s’agit du sujet barré comme sujet de l’inconscient qui n’a pas de corps à proprement parler. Ce sujet est articulé via le « poinçon » à l’objet a, élément de jouissance établissant un lien avec le corps vivant. Car même si, à cette époque, ce petit a demeure avant tout une image, Miller nous montre qu’il contient tout de même de la jouissance : « Ce fantasme comporte la vie, le corps vivant par l’insertion du petit a comme image incluse dans une structure signifiante, image de jouissance captée dans le symbolique[23]. » Le a concentre la pointe même du libidinal attaché au vivant. « Le poinçon <> veut dire, désir de[24]. » Dès lors, puisque la formation des symptômes implique l’interférence du fantasme, « c’est en quelque sorte ce dernier qui introduit, sous les espèces de la jouissance, le registre du corps dans le symptôme[25] ». En ce qui concerne l’interprétation, à cet époque l’analyste ne s’appuie pas sur le sens des signifiants mais sur comment ils s’articulent dans le symptôme : « … l’inconscient n’a de sens qu’au champ de l’Autre […] ce n’est pas l’effet de sens qui opère dans l’interprétation, mais l’articumation dans le symptôme des signifiants (sans aucun sens) qui s’y sont trouvés pris.[26] »
La profonde disjonction entre le signifiant et la jouissance demeure à cet époque. Dans son commentaire sur le Séminaire VII, L’éthique de la psychanalyse (1959-60), Miller explique que c’est là, sur cette barrière entre les deux que le symptôme s’établit. Une « impasse » surgit : « désir et fantasme ne saturent pas ce dont il s’agit dans la jouissance. […] La jouissance […] est l’équivalente à l’Autre barré. C’est ce qui fait de la jouissance l’Autre de l’Autre[27] ». Comment sortira-t-il de cette impasse ? Lacan « y parvient en faisant apparaître dorénavant la jouissance […] comme objet[28] ».
L’appareil du corps structuré comme l’inconscient
Dans les années soixante, la référence au fantasme demeurera essentielle. L’analyste mènera la cure à partir d’une place de semblant objet a. Cet objet a traversera des étapes importantes : surtout pendant les Séminaires X, L’Angoisse (1962-63) et XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse (1963-64) où le corps est fragmenté des pulsions partielles. Une « nouvelle alliance » émerge : une articulation étroite du symbolique et de la jouissance : « Il y a une communauté de structure entre l’inconscient symbolique et le fonctionnement de la pulsion[29] », explique Miller, qui cite Lacan : « Quelque chose dans l’appareil du corps est structuré de la même façon que l’inconscient[30]. » Autrement dit, l’inconscient est structuré comme une zone érogène, « comme un bord qui s’ouvre et qui ferme[31] ». L’une des préoccupations de Lacan durant ce période est de dire comment le corps – le vivant, la jouissance – est capturé par la structure, surtout si le corps « ne relève pas de la logique pur[32] ». Plus précisément, comment le sujet de l’inconscient « embraye sur le corps » grâce à l’objet a, et inversement, comment l’objet a est-il « appareillé au sujet »[33] ?
Dans les années soixante, si Lacan applique cette référence logique à l’objet, ce n’est toujours que dans un temps second – après le sujet – que cette dimension corporelle de l’objet entre en jeu. C’est ce que les deux opérations dans le Séminaire XI démontrent : 1) l’aliénation qui met en jeu le couple S1 – S2, montrant que le sujet barré est vide, mort et sans corps ; 2) la séparation qui introduit la dimension de l’objet a qui opère une récupération de libido parce qu’il « remplace cette perte de vie qui est la sienne d’être sexué[34] ». Malgré cette alliance entre signifiant et jouissance, une différence reste : « Il y a une matière signifiante, mais il y a une substance de jouissance, et c’est là ce que maintient la différence de l’objet et du signifiant[35]. » Quand il s’agit de l’interprétation analytique, cette différence est soutenue à cette époque : « Notre doctrine du signifiant est d’abord discipline […] aux modes d’effet du signifiant dans l’avènement du signifié, seule voie à concevoir qu’à s’y inscrire l’interprétation puisse produire du nouveau. [Car elle se fonde] dans le fait que l’inconscient ait la structure radicale du langage, qu’un matériel y joue selon des lois[36] ».
Un retour au corps
Finalement, « Radiophonie » (1970) et les Séminaire XVI, D’un autre à l’Autre (1968-69) et XVII, L’envers de la psychanalyse (1969-70), construisent une thèse déroutante par rapport aux développements lacaniens antérieurs. Avant, il y avait d’abord la structure de l’Autre et seulement ensuite la libido ou l’être vivant qui y était capturé. Désormais, telle est la rupture : « La relation signifiant/jouissance est une relation primitive et originaire. » Au temps de l’Autre préalable, le signifiant représentait un sujet pour un autre signifiant. Maintenant, « le signifiant représente une jouissance pour un autre signifiant ». Avant, il y avait « une logique autonome du signifiant indépendante des corps, en quelque sort transcendante au corps. [… Maintenant ] il y a là en effet un retour au corps. Toute cette logique est réinvestie et motivée par le rapport au corps[37]. » Lacan abjure l’autonomie du signifiant. Jouissance et sujet occupent la place de l’ensemble vide ; le sujet est manque-à-être, et jouissance est l’objet perdu.
Le plus-de-jouir qui fait trace dans le corps
Ce développement présent l’objet a comme plus-de-jouir : d’une part, le signifiant produit une mortification de la jouissance : il y a perte, déperdition. D’autre part, il y a un supplément ou excès de jouissance : le signifiant est en place de cause, et l’objet a est nommé désormais plus-de-jouir. La perte de jouissance induit son retour : un supplément de jouissance dans la répétition véhiculée par le signifiant sous forme de bouts, de fragments. « La notion de plus-de-jouir chez Lacan a pour fonction d’étendre le registre des objets petit a au-delà des objets en quelque sorte “naturels”, de les étendre à tous les objets de l’industrie, de la culture, de la sublimation… [38] » Pendant que l’objet petit a avait une consistance purement logique, l’objet a comme plus-de-jouir est l’effet de sujet situé dans le corps, fait trace dans le corps, et n’est pas pur effet de logique ; il est condensation de jouissance. Cette trace nous amènera à un corps bien vivant, réel, plus tard.
C’est un déplacement : la relation à la jouissance est non seulement pensée comme fantasme, elle est pensée comme répétition. « La répétition ne s’arrête pas. Tout ce qu’il nous est permit de jouir, c’est par petits morceaux […] les lichettes de la jouissance[39]. » Penser la jouissance comme répétition, c’est précisément ce qui conduira à une nouvelle valeur donnée au symptôme. Une avancée qui mènera à un changement radical dans le tout dernier enseignement de Lacan et sur la façon de penser l’interprétation.
En-corps – le changement radical
Dans les années soixante-dix, se dégage un nouvel abord du signifiant, de la jouissance, et du corps. Le développement de Lacan l’amène à défaire un nouage jusque-là fondamental : l’Autre et sa relation originaire avec la jouissance. C’est maintenant le corps qui est au premier rang – un corps vivant, bien réel. « Il y a jouissance, dira Miller, en tant que propriété d’un corps vivant, c’est-à-dire une définition qui rapporte la jouissance uniquement au corps vivant[40]. » Il n’y a de psychanalyse que d’un corps vivant qui parle. « N’est-ce pas là, demande Lacan, ce que suppose proprement l’expérience psychanalytique ? – la substance du corps, à condition qu’elle se définisse seulement de ce qui se jouit. […] nous ne savons pas ce que c’est que d’être vivant sinon seulement ceci, qu’un corps cela se jouit[41]. » Mais cette jouissance du corps, du réel, se passe de l’Autre. C’est « l’Une-jouissance[42] », dira Miller.
Nous n’avons plus un corps sublimé, signifiantisé, porté par le langage. Dans le Séminaire XX, Encore (1972-73), Lacan met en question le concept même du langage. Ce changement radical dans son enseignement fait que Lacan considère le langage comme un concept dérivé et non pas originaire, par rapport à ce qu’il invente d’appeler lalangue, « qui est la parole avant son ordonnancement grammatical et lexicographique[43] ». La parole également est déconstruite : elle ne permet ni de communiquer, ni d’être reconnu par l’Autre, mais de jouir. « C’est la jouissance du blablabla[44]. »
L’événement de corps
Une nouvelle définition du symptôme se construit : il n’est plus un « avènement de signification » cachée, cryptée, à déchiffrer, mais un « événement de corps[45] ». « Laissons le symptôme à ce qu’il est : un événement de corps[46] » dit Lacan en 1975. Cette phrase prendra une place déterminante dans les constructions de cas et « rendra compte de la question demeurée jusque-là opaque[47] » : où placer le corps vivant dans une analyse ? En fait, l’événement de corps désigne les éléments de discours qui ont laissé des traces dans le corps. Et ces traces dérangent le corps[48].
Si le symptôme est lié à l’incidence de la langue sur le corps, quid des effets sur l’interprétation ? “Cette définition du symptôme comme événement de corps rend beaucoup plus problématique le statut de l’interprétation qui peut y répondre[49].” Car si la structure même du langage perd sa place primaire est devient relativisée, si le langage n’apparaît plus que comme une élaboration de savoir sur lalangue, l’interprétation ne sera plus jamais ce qu’elle était. « Le terme du signifiant défaille à saisir ce dont il s’agit, car […] il peine à rendre compte du produit de jouissance[50]. » Autrement dit, avec le corps réel au premier rang, ce n’est plus une histoire de « faire sens ». Si on met l’accent sur la jouissance dans le symptôme, l’opposition clinique classique entre fantasme et symptôme est mise en question.
Le sinthome : événement de corps, consistance de jouissance
Alors Lacan a inventé le terme sinthome, un mixte de symptôme et fantasme. Pendant longtemps, le symbolique était le ressort de l’imaginaire, mais maintenant, c’est le réel qui est le ressort du symbolique. Dans les dessous de ce réel il y a quelque chose qui travaille, qui tourne : c’est « le singulier du sinthome, où ça ne parle à personne. C’est pourquoi Lacan le qualifie d’événement de corps. Ce n’est pas un événement de pensée […] C’est un événement de corps substantiel, celui qui a consistance de jouissance[51]. Si le point de vue du sinthome consiste à penser l’inconscient à partir de la jouissance, « Eh bien, ça a des conséquences sur la pratique, en particulier sur la pratique de l’interprétation. L’interprétation […] c’est éclairer la nature de défense de l’inconscient[52]. »
Comment s’y prendre pour éclairer la nature de défense ? Interpréter, est-ce déchiffrer ? Peut-être, mais déchiffrer c’est chiffrer à nouveau, et le mouvement ne s’arrête que sur une satisfaction car « la jouissance est dans le chiffrage[53] », dit Miller. Sinon, l’interprétation a-t-elle structure de délire ? Dans ce cas, elle consiste à retenir S2, à ne pas l’ajouter aux fins de cerner S1. « C’est reconduire le sujet aux signifiants proprement élémentaires sur lesquels il a, dans sa névrose, déliré[54]. » Ainsi, au lieu de nourrir le délire, le délire est affamé. Comment faire ? Miller propose trois principes : « l’éclair, l’énigme et le résidu, et l’étonnement[55] » pour cerner le au-delà du sens du sinthome. C’est une coupure – et non pas une ponctuation – avec des conséquences fondamentales pour la construction même d’une séance analytique. A-sémantique, hétérogène, n’impliquant « pas forcément une énonciation[56] », signifiant nouveau, jaculation, vocifération… voici des termes qui conviennent pour décrire ce qu’on nomme toujours « l’interprétation » à l’ère post-interprétative. Et non pas sans le corps ! C’est l’analyste qui joue à l’événement de corps, au semblant de traumatisme : il s’agit d’un instant : « l’instant de l’incarnation[57] ».
Quels mots, quel corps ?
Dans son intervention au colloque du 29 septembre à Gand, « Quels mots, quel corps », Anne Lysy a répondu très précisément à ce problème de nouage de langue et corps au cœur du dispositif analytique. Comment les mots ont-ils un impact, comment les mots touchent-ils à la jouissance ? Qu’est-ce qu’une « interprétation-événement » qui ne vise plus la révélation d’une vérité inconsciente, mais qui vise le réel du corps ? Le déchiffrage n’est pas suffisant, parce qu’il laisse en défaut le corps. Le corps doit y être avec ses objets voix, regard – c’est ça le réel du corps. Autrement dit, quand les mots d’une interprétation ont un impact, c’est lorsqu’ils produisent « le même effet sur le corps que le dire dont la pulsion est l’écho ». C’est précisément là où on parvient à opérer sur ladite pulsion. Car, comme Lacan a dit, « les pulsions, c’est l’écho dans le corps du fait qu’il y a un dire »[58]. « Une interprétation n’a de réelle portée que si elle a des effets sur la jouissance[59]. »
La fonction de l’inconscient se complète du corps
Anne Lysy nous a fait plusieurs exemples dans son texte (voir ci-dessus), mais ici je vais vous en donner trois. Le premier concerne la passe de Monique Kusnierek qui est devenue un paradigme. Après la fin de la séance, dans le couloir obscur qui mène à la porte, elle est amenée à se retourner parce qu’elle entend un bruit, une sorte de grognement : « Elle voit son analyste qui fait le geste d’une bête féroce prête à se jeter sur sa proie. » C’est une « pantomime de dévoration », commente Miller dans son cours, « L’expérience du réel »[60]. Il prend là cet exemple pour distinguer l’interprétation comme déchiffrage, qui concerne le refoulé et le retour du refoulé, et l’interprétation-dérangement de la défense ; je le cite : le déchiffrage laisse en défaut « que dans l’analyse il faut que l’un et l’autre apportent leur corps » ; l’interprétation-dérangement, elle, concerne le « parlêtre où la fonction de l’inconscient se complète du corps » – disons approximativement : « pas du corps symbolique, pas du corps imaginaire, mais de ce qu’il a de réel du corps ». Monique Kusnierek explique que le lieu, le geste de l’analyste, combinés au son constituent une scène qui s’inspire d’un cauchemar répété où pointe la pulsion orale, un se faire dévorer ; en même temps que la pulsion monte sur scène, l’analyste joue la bête féroce, c’est-à-dire il réduit l’Autre du fantasme à son semblant. Ce qui déclenche le rire. Cela fait dé-consister cet Autre, avec les conséquences qu’elle en tire.
Le geste
Suzanne Hommel a témoigné d’un geste inoubliable de Lacan : pendant une séance elle lui dit qu’elle se réveille chaque jour à 5h, que c’est l’heure où la Gestapo venait chercher les Juifs. Lacan se lève comme une flèche de son fauteuil, vient vers elle et lui fait une caresse extrêmement douce sur la joue. « J’ai compris geste-à-peau », dit-elle ; un geste surprenant, extrêmement tendre, qui n’a pas diminué la douleur mais en a fait autre chose. « Je l’ai encore sur la joue », dit-elle, 40 ans après ; « c’est aussi un appel à l’humanité, quelque chose comme ça ».
L’écho dans le corps
Une interprétation dont Véronique Voruz a témoigné qu’elle a appelée, « Exorcisme par équivoque » : celle qui après pas mal d’années a touché un symptôme récurrent rougissant ses yeux tel un monstre ou un diable. Là aussi, comme dans chaque exemple, le contexte et les mots en jeu sont singuliers. Sortie après de longues années d’une position d’invisibilité, stratégie pour se protéger du regard maternel haineux, ses prises de parole personnelles en public se paient par des infections oculaires récurrentes. C’est une retombée du regard maternel sur elle. Jusque-là des interprétations dans le registre des effets de sens, de vérité, n’avaient rien pu y faire. Un jour elle se précipite chez l’analyste : « C’est mon histoire d’yeux… ». L’analyste bondit, rugit : « Dieu ! Enfin je l’entends ! » et coupe la séance. Cette fois le symptôme cède, et avec lui la croyance en son « vieux bon dieu » à elle, celle d’être le monstre ou le diable dans la lignée des femmes. Cette interprétation touche à la fixation de jouissance, dit-elle. Qu’est-ce qui a opéré ? Outre l’homophonie, il y a le ton, le rugissement, la vocifération, et aussi la coupure de la séance.
Une fissure dans l’être du corps
Pour conclure, je voudrais résumer les cinq points/questions que Anne Lysy nous a proposés à la fin de son intervention qui nous serviront de boussole pour le prochain congrès :
- 1) Dans l’analyse, le déchiffrage n’est pas dépassé pour autant, parce que « pour traiter le symptôme il faut bien en passer par la dialectique du désir[61] ».
- 2) L’équivoque est considéré être la seule arme contre le sinthome. C’est un dire qui n’a pas de sens, comme moyen de toucher à l’irréductible des marques de jouissance. « Il faut lui ajouter la topologie de la poétique[62] », nous dit Laurent. Les interprétations-gestes sans mots relèvent-ils de l’équivoque ?
- 3) Il y a des différents registres du sonore : les effets de voix, la tonalité peuvent faire qu’il y a quelque chose dans le signifiant qui résonne. Y a-t-il un mode de dire qui accentue, dans le signifiant, la matérialité du son, qui pourrait faire résonner la cloche de la jouissance ? S’agit-il alors d’une satisfaction ou d’une coupure. Une jaculation est-elle plus efficace ? Quid du silence ?
- 4) Lacan a pu dire que l’analyste est un sinthome ; Miller propose qu’il « joue à l’événement du corps, au semblant du traumatisme[63] ». Y mettre le corps, est-ce produire le même effet sur le corps que le dire dont la pulsion est l’écho, pour parvenir à opérer sur ladite pulsion ?
- 5) Qui interprète ? La parole analysante produit-elle parfois un dire, qui a des effets ? N’aurait-il son effet que par la coupure ?
Comme dit Anne Lysy, il ne s’agit pas évidemment d’idéaliser ou d’imiter un style d’analyste, ni de fixer une nouvelle technique psychanalytique (sautez, grimacez, criez…). À l’ère post-interprétative il s’agit plutôt d’une tentative de chercher « le vide de la pensée[64] », ou, dans les mots de Éric Laurent, d’introduire « une fissure dans l’être du corps » là où se trouve « la pure trace d’un hors-sens qui a fini par éteindre les faux chatoiements de la croyance au symptôme[65] ». Si, comme dit Miller[66], pour les thérapies qui procèdent par la parole, la question du réel est instante, il s’agit d’une nouvelle invention au cas par cas marquée par l’urgence.
[1] Seynhaeve, Bernard, « L’interprétation : de la vérité à l’événement », argument du congrès 2020 de la NLS, en ligne sur http://www.amp-nls.org
[2] Cf. Lysy, Anne, « Inconscient et interprétation ».
[3] Cf. Castanet, Hervé, Comprendre Jacques-Alain Miller, illus. S. Strassmann, Max Milo, Paris, 2015, p. 92.
[4] Lysy, Anne, « Quels mots, quel corps », intervention lors du colloque organisé par la NLS, Avant-première : La passe dans notre École, l’interprétation encore, le 29 septembre 2019 à Gand.
[5] Miller, Jacques-Alain, « L’interprétation à l’envers », La Cause freudienne, n° 32, 1996.
[6] Miller, Jacques-Alain, « L’inconscient et le corps parlant », La Cause du désir, n° 88, Navarin, Paris, 2014, p. 109.
[7] Lacan, Jacques, « Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je telle qu’elle nous est révélée dans l’expérience psychanalytique », Écrits, Seuil, Paris, 1966, p. 97.
[8] Bassols, Miquel, « Le corps et les jouissances », intervention lors de la conférence au même titre organisée par le Pont freudien en 2003 à Montréal, http://pontfreudien.org/content/miquel-bassols-le-corps-et-ses-jouissances
[9] Lacan, Jacques, « Le stade du miroir », Écrits, op. cit. p. 93.
[10] Ibid., p. 94.
[11] Lacan, Jacques, Le séminaire, livre II, Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, Seuil, Paris, 1978, p. 134.
[12] Lacan, Jacques, « Fonction et champ dans la parole et du langage en psychanalyse », Écrits, op. cit., p. 302 ; « le symptôme se résout tout entier dans une analyse de langage, parce qu’il est lui-même structuré comme un langage, qu’il est langage dont la parole doit être délivrée », p. 269.
[13] Laurent, Éric, « L’interprétation : de la vérité à l’événement », texte d’orientation du congrès 2020 de la NLS, http://www.amp-nls.org/page/fr/170/le-congrs
[14] Lacan, Jacques, « Fonction et champ dans la parole et du langage en psychanalyse », Écrits, op. cit., p. 281.
[15] Miller, Jacques-Alain, « L’image du corps en psychanalyse », La Cause du désir, n° 68, Navarin, Paris, 2008, p. 94.
[16] Lacan, Jacques, « La direction de la cure et les principes de son pouvoir », Écrits, op. cit., p. 634.
[17] Ibid., p. 641.
[18] Laurent, Éric, « L’interprétation : de la vérité à l’événement », op. cit.
[19] Ibid.
[20] Ibid.
[21] Guyonnet, Damien, « Le sujet de l’inconscient et le corps », Lire Lacan au XXIème siècle, coor. F. Hulak, Champ social éditions, Nîmes, 2019, p. 250.
[22] Lacan, Jacques, Le séminaire, livre VI, Le désir et son interprétation, La Martinière,-Champ freudien, Paris, 2013 , p. 434.
[23] Miller, Jacques-Alain, « Les six paradigmes de la jouissance », La Cause freudienne, n° 43, Navarin, Paris, 1999, p. 7.
[24] Castanet, Hervé, Comprendre Jacques-Alain Miller, op. cit., p. 84.
[25] Guyonnet, Damien, « Le sujet de l’inconscient et le corps », Lire Lacan au XXIème siècle, op. cit., p. 251.
[26] Lacan, Jacques, « Position de l’inconscient », Écrits, op. cit., p. 842.
[27] Miller, Jacques-Alain, « Les six paradigmes de la jouissance », http://www.causefreudienne.net/wp-content/uploads/2015/04/JAM-Six-paradigmes-jouissance.pdf
[28] Ibid.
[29] Ibid.
[30] Lacan, Jacques, Le Séminaire, Livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Paris, Le Seuil, 1974, p. 165.
[31] Miller, Jacques-Alain, « Les six paradigmes de la jouissance », op. cit.
[32] Miller, Jacques-Alain, « Habeas corpus », La Cause du désir, n° 94, Navarin, Paris, 2016, p. 166.
[33] Guyonnet, Damien, « Le sujet de l’inconscient et le corps », Lire Lacan au XXIème siècle, op. cit., p. 253-254.
[34] Lacan, Jacques, « Position de l’inconscient au congrès de Bonneval reprise de 1960 en 1964 », Écrits, op. cit., p. 849.
[35] Miller, Jacques-Alain, « Les six paradigmes de la jouissance », op. cit. (mes italiques).
[36] Lacan, Jacques, « La direction de la cure et les principes de son pouvoir », Écrits, op. cit, p. 594 (mes italiques).
[37] Miller, Jacques-Alain, « Les six paradigmes de la jouissance », op. cit.
[38] Ibid.
[39] Ibid.
[40] Ibid.
[41] Lacan, Jacques, Le séminaire, livre XX, Encore, Seuil, Paris, 1975, p. 26.
[42] Miller, Jacques-Alain, « Les six paradigmes de la jouissance », op. cit.
[43] Castanet, Hervé, Comprendre Jacques-Alain Miller, op. cit., p. 90.
[44] Miller, Jacques-Alain, « Les six paradigmes de la jouissance », op. cit.
[45] Miller, Jacques-Alain, « L’expérience du réel dans la cure psychanalytique », enseignement prononcé dans le cadre du Département de psychanalyse de l’université Paris 8, leçon du 26 mai 1999.
[46] Lacan, Jacques, « Joyce le symptôme », Autres écrits, Seuil, Paris, 2001, p. 569.
[47] Castanet, Hervé, Comprendre Jacques-Alain Miller, op. cit., p. 94.
[48] Miller, Jacques-Alain, « L’expérience du réel dans la cure psychanalytique », op. cit., leçon du 9 juin 1999.
[49] Miller, J.-A., « Biologie lacanienne et événement de corps », La Cause freudienne, n° 44, Navarin, Paris, 2000.
[50] Miller, Jacques-Alain, « L’interprétation à l’envers », La Cause freudienne, op. cit.
[51] Miller, J.-A., “L’inconscient et le sinthome”, La Cause freudienne, n° 71, « Au-delà de la clinique », Navarin, Paris, 2009, p. 72-79.
[52] Ibid., cité dans Seynhaeve, Bernard, « L’interprétation : de la vérité à l’événement », argument du congrès 2020 de la NLS, en ligne sur http://www.amp-nls.org
[53] Miller, Jacques-Alain, « L’interprétation à l’envers », La Cause freudienne, op. cit.
[54] Ibid.
[55] Miller, Jacques-Alain, « L’esp d’un lapsus », L’orientation lacanienne. Le tout dernier Lacan (2006-2007), enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’Université Paris 8, leçon du 22 novembre 2006, in « ¡ Urgent ! », The Lacanian Review, n° 6, NLS, Paris, 2018.
[56] Lacan J., Le Séminaire XXII, « R.S.I », Séance du 11 février 1975, texte établi par J.-A. Miller, Ornicar ?, n° 4, p. 95-96.
[57] Miller, J.-A., “L’inconscient et le sinthome”, La Cause freudienne, n° 71, Navarin, Paris, 2009, p. 72-79, cité dans Seynhaeve, Bernard, « L’interprétation : de la vérité à l’événement », argument du congrès 2020 de la NLS, en ligne sur http://www.amp-nls.org
[58] Lacan, Jacques, Le séminaire, livre XXIII, Le sinthome, Seuil, Paris, 2005, p. 17.
[59] Lysy, Anne, « Inconscient et interprétation », Cahier du Congrès de la NLS 2008, p. 10, commentant le cours de J.-A. Miller, « Tout le monde est fou », 12 mars 2008.
[60] Miller, Jacques-Alain, « L’expérience du réel dans la cure psychanalytique », op. cit., leçon du 27 janvier 1999.
[61] Miller, Jacques-Alain, « Lire un symptôme”, Mental, n° 26, 2011, p. 58.
[62] Laurent, Éric, « L’interprétation : de la vérité à l’événement », op. cit.
[63] Miller, J.-A., “L’inconscient et le sinthome”, La Cause freudienne, op.cit., p. 72-79.
[64] Lacan, J, « Propos sur la causalité psychique » Écrits, op. cit., p. 188.
[65] Laurent, Éric, « L’interprétation : de la vérité à l’événement », op. cit.
[66] Miller, Jacques-Alain, « L’orientation lacanienne. L’Un tout seul », enseignement prononcé dans le cadre du Département de psychanalyse de l’Université Paris 8, cours du 26 janvier 2011, inédit.
Lacan, l’interprétation et le Zen
Frank Rollier
Les élaborations successives de Lacan concernant les modalités d’interprétation de l’analyste sont émaillées de multiples références au Zen. Ayant commencé à étudier le chinois au début des années 40 et par la suite voyagé au Japon, son enseignement est marqué par son intérêt soutenu pour le bouddhisme[1], le taoïsme[2], la langue japonaise[3] et l’écriture qui la travaille[4], perspectives que nous ne développerons pas ici.
En ouverture de son premier séminaire, il signale la technique du maître Zen qui « interrompt le silence par n’importe quoi, un sarcasme, un coup de pied », en la référant à la « recherche du sens ». A cette époque, Lacan fixe précisément pour tâche à « l’art de l’analyste […] de réintroduire le registre du sens[5] », non sans « suspendre les certitudes du sujet[6] ». Il suit alors la direction ouverte par Freud et l’interprétation reste basée sur le déchiffrage de l’inconscient[7] pensé comme une chaine signifiante S1-S2, « le chapitre censuré[8] » de l’histoire du sujet. Chez ce premier Lacan, l’interprétation a lieu au niveau symbolique et elle vise le signifiant, ce qui implique aussi « qu’elle soit brève[9] ». En 1959, dans son séminaire sur Le désir et son interprétation, il met en valeur la coupure du discours de l’analysant, qui « est la scansion essentielle où s’édifie la parole[10] » et vise « à rétablir la cohérence de la chaîne signifiante au niveau de l’inconscient[11] ». La vérité est alors un concept clef de son enseignement et il soutient qu’elle « peut être retrouvée[12] ».
L’ « effet de rupture[13] » produit par le « n’importe quoi » du maître Zen peut être rapproché du constat fait par Lacan dans le séminaire Le transfert que « …la mouche ou la guêpe, ou n’importe quoi qui fait du bruit, qui nous surprend (…) peut avoir une fonction opératoire tout à fait suffisante à mettre en question la réalité et la consistance de l’illusion du Moi[14] ».
Un virage se produit en 1964 avec le Séminaire Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, dans lequel Lacan énonce que l’interprétation « n’est pas ouverte à tous les sens » mais que ce qui est essentiel est que l’analysant voie « à quels signifiants irréductibles, faits de non–sens, non-sensical […] il est, comme sujet, assujetti[15] ». C’est en conclusion de ce séminaire, qu’il avance que le désir de l’analyste est d’isoler l’objet petit a[16], pour que « le sujet se voit causé comme manque par a[17] ».
Rapporté à l’analyse, le « n’importe quoi » par lequel le maître Zen opère, acquiert alors une fonction précise. En effet, si l’interprétation prend encore la forme d’une coupure du discours de l’analysant, c’est pour viser un au-delà du signifiant, le lieu où se situe la fonction de jouissance que Lacan nomme petit a[18]. Ainsi, c’est « le vide de l’absence première de l’objet » qui est pointé, écrit Éric Laurent, ajoutant que « là est la version psychanalytique du vide bouddhique et de la vacuité qu’il s’agit de produire dans l’expérience[19] ».
Dans le séminaire L’objet de la psychanalyse, Lacan rappelle que « chacun sait qu'un exercice Zen, ça a tout de même quelque rapport, encore qu'on ne sache pas bien ce que ça veut dire, avec la réalisation subjective d'un vide […] vide mental qu'il s'agit d'obtenir et qui serait obtenu, ce moment singulier, brusquerie succédant à l'attente qui se réalise parfois par un mot, une phrase, une jaculation, voire une grossièreté, un pied de nez, un coup de pied au cul ». Lacan relève donc à nouveau le mode opératoire du maître qui peut aller jusqu’à impliquer son corps, ajoutant qu’il « est bien certain que ces sortes de pantalonnades ou clowneries n'ont de sens qu'au regard d'une longue préparation subjective[20] ».
En 1972, l’année du séminaire Encore, son ancien professeur de chinois Paul Demiéville publie une traduction des Entretiens de Lin-Tsi, un célèbre maître Zen du IXème siècle. Lacan revient alors sur la méthode Zen, notant que le bouddhisme peut comporter le « renoncement à la pensée elle-même ». Il ajoute que « ce qu’il y a de mieux dans le bouddhisme, c’est le Zen, et le Zen, ça consiste à ça, à te répondre par un aboiement, mon petit ami[21] ». Dès lors et jusqu’à la fin de son enseignement, il mettra en valeur la dimension hors-sens de l’interprétation de l’analyste, en la référant aux interventions d’un maître Zen. Lin-Tsi est un représentant du bouddhisme Chan qui se développe en Chine à partir du VIème siècle, puis apparaîtra deux siècles plus tard au Japon sous le nom de Zen. Cette école, dite aussi subitiste, prône l’éveil subit et non pas graduel tel qu’il était enseigné par le bouddhisme traditionnel, basé sur l’étude des textes et la méditation. Le Chan a été influencé par le taoïsme qui était déjà présent en Chine et prônait Wuwei, le non-agir.
Lin-Tsi raille la méditation assise « la langue collée au palais[22] » (appelée Dhyâna en Inde et Zazen au Japon). Il jouait plutôt de la gifle, de la bastonnade et surtout du khât, une éructation dont il était le virtuose et qui fusait dès qu’un élève hésitait et se laissait « empêtrer dans toutes ces lianes parasites de vains mots[23] », ce qui peut évoquer la « parole vide » dénoncée par Lacan, ce « discours de l’imaginaire[24] » qui ne permet pas au désir du sujet de s’affirmer en tant que Je, « en première personne[25] ».
Le maître Zen insiste : « comprendre ou ne pas comprendre, tout cela est faux[26] », « toute délibération faisant manquer le but[27] » ; au contraire, l’élève à qui l’on pose une question doit « avoir la vue juste[28] » et une réaction « instantanée, comme le feu du briquet ou la lueur de l’éclair » ; elle doit jaillir des profondeurs de « l’homme vrai[29] » et suppose « l’arrêt de toute pensée[30] ». Ce que Lin-Tsi appelle « l’arbre de l’éveil[31] » est à ce prix.
Le khât est sans signification, c’est un hors-sens qui vise à désarçonner l’élève et provoquer chez lui une « absorption immédiate » (ce que signifie l’idéogramme Chan) ou au moins susciter un « je ne comprends pas[32] ». Il s’agit de faire pièce au désir de connaître la vérité ultime, ce qu’illustre par exemple le mythe populaire du singe Souen qui, après une vie passée à combattre les démons par monts et par vaux, arrive finalement dans une grotte où il découvre les rouleaux sacrés. Mais, une surprise l’attend : ceux-ci sont « blancs comme neige, sans aucune trace d’écriture ». Alors, Souen « tombe sur le sol, foudroyé[33] ».
Lacan s’est lui aussi toujours élevé contre la compréhension : comprendre les psychotiques est qualifié de « pur mirage[34] » et concernant la cure, il dira que « c’est bien plus dans le repérage de la non-compréhension [...] que quelque chose peut se produire qui soit avantageux dans l’expérience analytique[35] ».
Quand Lacan relève « l’aboiement » du maitre Zen, il fait explicitement référence au khât, dont Lin-Tsi distingue quatre formes : « Parfois un khât est comme l’épée précieuse du roi-diamant ; parfois un khât est comme un lion aux poils d’or tapi sur le sol ; parfois un khât est comme une perche à explorer, munie d’herbes qui font ombre ; parfois un khât ne fait pas office de khât. Comment comprends-tu cela[36] ? »
Risquons-nous à transposer librement ces modalités du khât à la cure analytique et à proposer quelques hypothèses : « une épée précieuse » comme un diamant, telle pourrait être l’interprétation inoubliable dont peuvent témoigner certains analystes de l’École (A.E.). « Comme un lion tapi sur le sol », évoque bien sûr l’acte de l’analyste que Freud compare au « lion [qui] ne bondit qu’une fois[37] ». « Comme une perche à explorer », pourrait figurer une interprétation qui relance les associations d’idées sur la chaine signifiante. Quant au « khât qui ne fait pas office de khât », Nathalie Charraud, qui est l’auteure d’un article de référence sur « Lacan et le bouddhisme Chan », propose que « c’est que le transfert est dépassé, que l’analysant saisit que l’intervention se réduit effectivement à un non-sens, ou plutôt quelle [dé]montre l’absence de sens de ce que J.-A. Miller a appelé l’inconscient réel[38], un réel qui est sans relation avec quoi que ce soit, qui ne peut se référer à aucun signifiant[39] ».
Dans le séminaire RSI, Lacan évoque « l’interprétation analytique [qui] porte d’une façon qui va beaucoup plus loin que la parole », et « n’implique pas forcément une énonciation[40] ». Il se demande alors si un « effet de sens qui soit réel », c’est-à-dire « en tant qu’il fait nœud », peut résulter « de l’emploi des mots ou de leur jaculation[41] » – modalité d’interprétation qu’il avait déjà mentionnée à propos de la pratique Zen. J.-A. Miller soulignera que la jaculation, qui avant tout met en jeu la voix, « vise la substance jouissante[42] ». A ce temps de son enseignement, l’interprétation ne s’adresse plus à l’inconscient en tant que chaine signifiante, mais à ce que Lacan appelle le parlêtre, ce nouage entre le corps et le langage ; elle cherche à provoquer un événement[43] dans le corps parlant, ce que J.-A. Miller a qualifié d’« interprétation à l’envers » de l’inconscient[44]. Il faut qu’elle « passe dans les tripes[45] », disait Lacan.
Si Lin-Tsi déclarait : « C’est de tout mon corps que j’agis à votre égard[46] », l’analyste lacanien peut lui aussi y mettre de son corps en incarnant l’objet petit a, en jouant à l’événement de corps, « au semblant de traumatisme[47] ». Cet « analyste objet petit a, écrit É. Laurent, c’est l’analyste qui fait des choses qui ne se font pas, qu’on n’attend pas […] avec son corps[48] ».
Lacan va jusqu’à évoquer « la portée d’un dire silencieux », d’une intervention qui s’effectue sans que l’analyste dise un seul mot, ce qui peut résonner avec le Cha, une variante du khât mentionnée par Lin-Tsi, qui est « une exclamation la voix coupée[49] », qualifiée de « silence du tonnerre ».
Comme le coup de bâton ou le khât du maître Zen, l’interprétation de l’analyste doit casser la logique signifiante, car il s’agit de « faire résonner autre chose que le sens[50] », précise Lacan dans le séminaire Les non dupes errent. En effet, c’est quand « le sens même des mots se suspend », que « le mode du possible émerge[51] ». Le maniement de l’équivoque signifiante en est la modalité essentielle, car elle ouvre sur une pluralité de sens possibles, voire sur le non-sens. La catégorie du possible, de ce qui cesse de s’écrire, s’oppose à celle du nécessaire, dont relève le symptôme qui, lui, ne cesse pas de s’écrire, de se répéter. Ce qui permet aussi à Lacan d’avancer logiquement qu’une « interprétation juste » peut « éteindre un symptôme[52] ».
Si l’art du maitre Zen semble accompagner si étroitement le work in progress de Lacan sur l’interprétation analytique, ne faisons pas pour autant l’erreur de faire de celle-ci une variante de la technique Zen. La pratique de Lin-Tsi repose sur une croyance en l’éveil de l’élève qui, après « s’être épuré (comme un minerai) et poli (comme un miroir de bronze)[53], saura « distinguer le faux du juste […] le bien et le mal » ; alors il « possédera les super-savoirs » et « la radiance de son corps illuminera d’elle-même[54] ». Le moine Wúmén Huìkāi, raconte ainsi son propre éveil[55] :
Un coup de tonnerre dans un ciel ensoleillé,
Tous les êtres sur terre écarquillent les yeux.
L’univers en un seul mouvement s'incline,
Le Mont Sumeru saute de joie et danse.
La thèse de Lacan est au contraire qu’« on ne se réveille jamais : les désirs entretiennent les rêves et il ajoute que « le réveil total […] qui consisterait à appréhender le sexe […] c’est la mort ». Évoquant « la religion nirvanesque », il avance que le « réveil absolu du bouddhisme », figuré par le Nirvana, « relève du mythe », qu’il est une « part de rêve qui est justement de rêve de réveil[56] ».
Toutefois, si espérer se réveiller réellement n’est qu’un rêve, J.-A. Miller avance que « le désir de réveil est le désir de l’analyste » et que « ça n’interdit pas de prendre [le réveil] pour fin[57] ». Avec cet horizon, l’orientation par le réel, c’est à dire par la jouissance qui affecte le corps, fraye la voie d’un possible réveil de l’analysant, mais ce ne peut être qu’au cas par cas : « Il n'y a d'éveil que singulier[58] » et, ainsi que le précise É. Laurent, il s’agit d’un « éveil à la dimension de la singularité du symptôme[59] ».
La psychanalyse fait place à l’étrangeté unique de chaque sujet, qui est marqué par la nécessité de vivre avec son symptôme ou sinthome, et pour lequel ex-sister devient possible face à un Autre qui n’existe pas.
[1] En particulier :
- Lacan, J., « Les paupières de Bouddha », Le séminaire, Livre X, L’angoisse, Seuil, Paris, 2004, p. 247-264.
- Lacan, J., « Subversion du sujet et dialectique du désir dans l’inconscient freudien », Écrits, Seuil, Paris, 1966, p. 826-827.
[2] Lacan, J., Le séminaire Livre XX, Encore, Seuil, Paris, 1975, p.104.
[3] Lacan, J., « Avis au lecteur japonais », Autres écrits, Seuil, Paris , 2001, p. 497.
[4] Lacan ,J., « Lituraterre », ibid., p. 19.
[5] Lacan, J., Le Séminaire, Livre I, Les écrits techniques de Freud, Seuil, Paris, 1975, p. 8.
[6] Lacan, J., « Fonction et champ de la parole et du langage », Écrits, op. cit., p. 251.
[7] Miller, J.-A., « L’orientation lacanienne, Choses de Finesse », enseignement prononcé dans le cadre du Département de psychanalyse de l’université Paris 8, leçon du 20 mai 2009, inédit.
[8] Lacan, J., « Fonction et champ de la parole et du langage », Écrits, op. cit., p. 259.
[9] Lacan, J., Le Séminaire, Livre V, Les formations de l’inconscient, Seuil, Paris, 1998, p. 444.
[10] Lacan, J., Le Séminaire, livre VI, Le désir et son interprétation, Seuil, Paris, 2013, p. 564
[11] Ibid., p. 351.
[12] Lacan, J., « Fonction et champ de la parole et du langage », Écrits, op. cit., p. 259.
[13] Laurent, É., « L’interprétation, de la vérité à l’événement », texte d’orientation du Congrès 2020 de la New Lacanian School : https://www.nlscongress2020.com/nlscongrs/le-texte-dorientation.
[14] Lacan, J., Le Séminaire, Livre VIII, Le Transfert, Seuil, Paris, 1991, p. 437.
[15] Lacan, J., Séminaire XI, op. cit., p. 226.
[16] Ibid., p. 245.
[17] Ibid., p. 243.
[18] Miller, J.-A., « Nous sommes tous ventriloques », Filum n° 8/9, p. 21-22.
[19] Laurent, É., « L’interprétation : de la vérité à l’événement », op. cit.
[20] Lacan, J., Le Séminaire XIII « L’objet de la psychanalyse », cours du 15 décembre 1965 (inédit).
[21] Lacan, J., Le Séminaire Livre XX, Encore, op. cit., p. 104.
[22] Demiéville, P., Entretiens de Lin-Tsi, Fayard, Paris, 1972, p. 131.
[23] Ibid., §1, p. 28.
[24] Miller, J.-A., « Index raisonné des concepts majeurs », in Lacan, J., Écrits, op. cit., p. 899.
[25] Lacan, J., « Fonction et champ de la parole et du langage », ibid., p. 251
[26] Demiéville P., op. cit. §7, p. 40.
[27] Ibid., § 28, p. 134.
[28] Ibid., § 11, p. 55.
[29] Ibid., § 3, p. 31.
[30] Ibid., § 22, p. 122.
[31] Ibid.
[32] Ibid., § 66, p. 205.
[33] Tristan, F., Le singe, égal du ciel, C. Bourgois, Paris, 1972, p. 530.
[34] Lacan, J., Le Séminaire, livre III, Les Psychoses, Seuil, Paris, 1981, p. 14.
[35] Lacan, J., « Petit discours aux psychiatres », conférence du 10 novembre 1967 (inédit).
[36] Demiéville, P., Entretiens de Lin-tsi, op. cit., § 61, p. 195.
[37] Freud S., « L'analyse avec fin et l'analyse sans fin », Résultats, idées, problèmes, tome II, Paris, PUF, 1985, p. 234.
[38] Miller, J.-A., « L’inconscient réel », Quarto, n° 88-89.
[39] Charraud N, « Lacan et le bouddhisme Chan », La Cause Freudienne n° 79, p. 122-126. Une version plus élaborée de ce texte est disponible sur le site lacanchine.com à l’adresse : http://www.lacanchine.com/Charraud_03.html
[40] Lacan, J., Le séminaire XXII, RSI, séance du 11 février 1975 (inédit).
[41] Ibid.
[42] Miller, J.-A., « L’orientation lacanienne, Choses de finesse en psychanalyse », op. cit.
[43] Miller, J.-A., « L’inconscient et le corps parlant », La Cause du désir n° 88, p 34.
[44] Miller J.-A., « L’interprétation à l’envers », La Cause freudienne n° 32, p. 9-13.
[45] Lacan, J., Séminaire XXI, Les non dupes errent, leçon du 19 février 1974 (inédit).
[46] Demiéville P., Entretiens de Lin-tsi, op. cit., p. 166.
[47] Miller, J.-A., « L’inconscient et le sinthome », La Cause freudienne n° 71, p. 79.
[48] Laurent É., « Sur L’envers de la biopolitique », Quarto 115-116, p 17.
[49] Demiéville P., Entretiens de Lin-tsi, op. cit., p. 228.
[50] Lacan J., Le Séminaire XXIV, L’insu qui sait de l’une-bévue s’aile à mourre, 19 avril 1977 (inédit).
[51] Lacan J., Le Séminaire XXI, Les non dupes errent , 8 janvier 1974 (inédit).
[52] Ibid., 18 décembre 1973 (inédit).
[53] Demiéville, P., Entretiens de Lin-tsi, op. cit. p. 116.
[54] Ibid., p. 123.
[55] Cf. http://www.truclamthienvien.fr/index.php/documents/192-l-eveil-subit-et-l-eveil-graduel-dans-le-bouddhisme-zen
[56] Lacan, J., « Improvisation. Désir de mort, rêve et réveil », L’âne n° 3, 1974.
[57] Miller, J.-A., « Réveil », Ornicar ?, n° 20-21, p. 51.
[58] Lacan, J., « Peut-être à Vincennes », Ornicar ?, n° 1, 1975, p. 5.
[59] Laurent, É., « Semblants et sinthome », Quarto n° 97, p. 16.